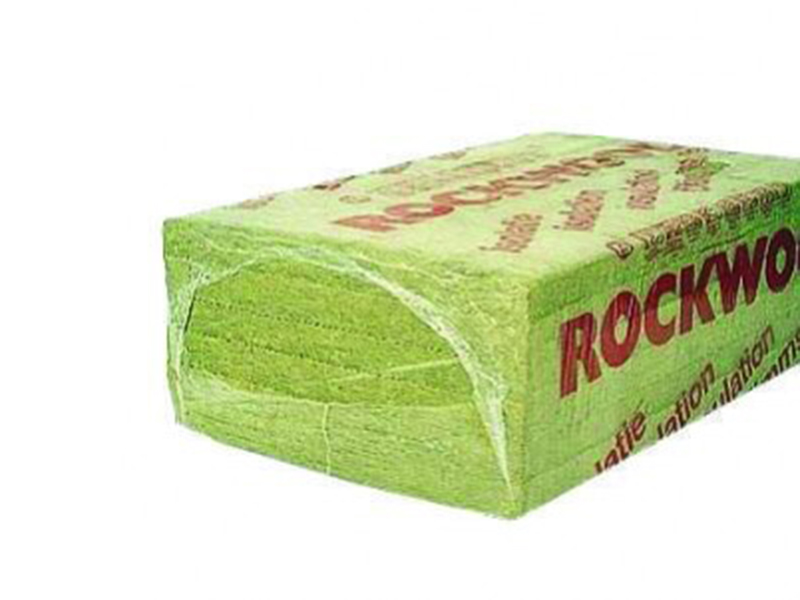L’isolation adéquate pour un environnement de travail plus sûr
L’isolation en entreprise et l’isolation industrielle contribuent à l’amélioration de la sécurité et du bien-être au travail. Ces opérations permettent de mieux maîtriser les températures ambiantes et celle des différentes installations du poste de travail.
Lutter contre le froid sur les environnements de travail
Le froid hivernal et/ou artificiel est une source d’inconfort majeure pour les salariés exerçant leurs activités en extérieur ou dans des locaux mal isolés.
Isolation de l’entreprise
Les travaux d’isolation en entreprise peuvent s’imposer afin de respecter les obligations de l’employeur prévues par le Code du Travail. Les dispositions du texte ne donnent pas directement de température minimale, mais elles rendent l’employeur responsable de la santé et de la sécurité du personnel.
Il existe toutefois des seuils généralement admis, comme celui de 19 °C minimum dans les bureaux et d’une température idéale située entre 20 °C et 23 °C, compte tenu de la sédentarité des activités. On retrouve notamment ces valeurs dans les communications de l’INRS, l’Institut national de recherche et de sécurité.

Isolation industrielle
L‘isolation des locaux industriels est tout aussi cruciale pour l’optimisation des conditions de travail. Attention, le froid ne provient pas toujours de l’extérieur. Chambre froide, entrepôt frigorifique… Dans ces configurations, les salariés sont exposés à un froid extrême : -55 °C pour le stockage du poisson surgelé, -28 °C pour les produits congelés et entre 2 °C et 12 °C pour la préparation et le transport de produits frais.
Ici, ce sont davantage les conditions de travail et les temps d’intervention qui permettent de réduire les risques pour les salariés. Les actions d’isolation industrielle ont notamment pour objectif d’optimiser les coûts très importants de la production du froid artificiel.
Le calorifugeage des tuyauteries de chauffage
Le calorifugeage est une opération qui consiste à isoler les tuyaux d’eau chaude. On parle également de calorifugeage pour l’isolation des tuyaux d’eau froide. Dans les deux cas, l’isolation des conduits permet de mieux préserver la chaleur ou la fraîcheur produite et acheminée. Le calorifugeage industriel s’applique aux tuyauteries de chauffage, mais pas seulement. Ces opérations peuvent aussi viser les installations industrielles comme les fours ou les chambres froides.
Réduire les nuisances sonores sur le poste de travail
Les nuisances sonores sont une autre source d’inconfort pouvant aller jusqu’à entraîner des phénomènes irréversibles comme la surdité du salarié exposé.
Bruit : isolation en entreprise et isolation industrielle
Les opérations d’isolation phonique sont pertinentes quelle que soit la nature des activités exercées. Ce qui change, c’est la nature du risque. Il est avéré dangereux sur les chantiers ou sur les sites industriels à proximité des machines… Au bureau, les nuisances ne présentent à priori pas de danger pour l’audition, mais peuvent entraîner des troubles de la concentration, du stress ou encore affecter la qualité du sommeil. L’isolation phonique des pièces et la mise en place de dispositifs anti-bruit, y compris des Équipements de Protection Individuelle (EPI), font partie des mesures à mettre en place pour offrir des conditions de travail optimales aux salariés.
L’isolation phonique des tuyauteries
Tous les locaux sont potentiellement concernés par l’émission et la diffusion du bruit par les tuyauteries. Les canalisations représentent en effet une source d’émission et un vecteur de diffusion du bruit entre différentes pièces et/ou étages. L’isolation phonique des tuyauteries est donc à considérer, en plus des opérations classiques d’isolation acoustique des murs intérieurs de la bâtisse.

Brûlure, accident : les risques liés à la chaleur au travail
La chaleur, quand elle est excessive, est un facteur de risque à maîtriser sur les environnements de travail.
Des locaux trop chauds
Cette chaleur excessive peut être subie en été dans des locaux mal isolés. Il existe des températures idéales et maximales généralement admises, comme dans le cas de la température minimale en hiver. Un bilan thermique, suivi le cas échéant d’actions d’isolation thermique adaptées, permet de respecter plus facilement et à moindre coût ces températures idéales.
Un poste de travail à risque
Dans certains domaines, comme la sidérurgie ou la verrerie, ce ne sont pas les locaux, mais les postes de travail qui exposent les salariés à la chaleur. Par ailleurs, les métiers associés à l’effort physique exposent davantage le personnel dans un contexte de forte chaleur.
Le chaud est moins bien toléré lorsque le corps est déjà mis à rude épreuve par la réalisation de travaux physiques pénibles. Pour toutes ces activités, les risques peuvent être évalués grâce à des bilans thermiques ciblés permettant d’établir l’indice d’Astreinte Thermique Prévisible (ATP).
L’isolation thermique des fours industriels
La bonne isolation des fours industriels contribue à maintenir une température acceptable à proximité des équipements qui produisent de fortes chaleurs.
La détermination de l’indice ATP pour un cueilleur de verre devant un four dépendra de la température ambiante, de l’humidité, de la vitesse de l’air, mais aussi de la température de rayonnement du four. Ici, cette température peut dépasser les 70 °C ce qui suppose la mise en place d’écrans, pouvant être amovibles, devant les fours afin de protéger les employés.
L’organisation des locaux peut aussi jouer un rôle dans l’amélioration du confort thermique et la maitrise du risque, en tâchant d’éloigner les postes de travail des sources de chaleur dès que possible.